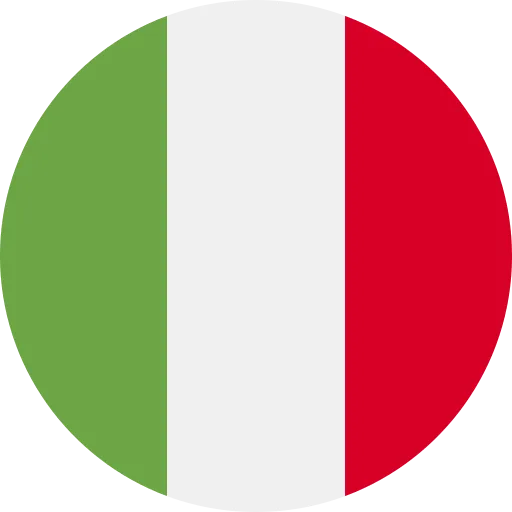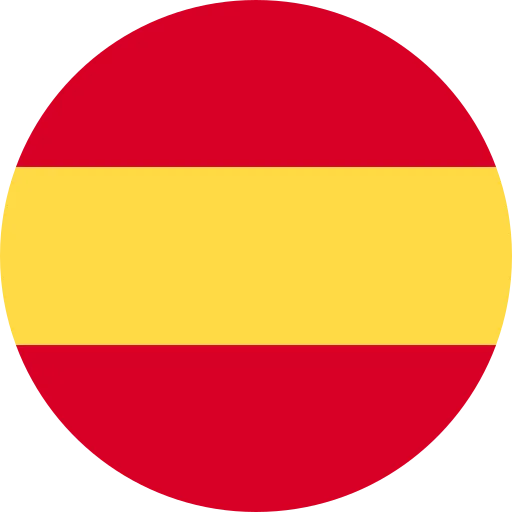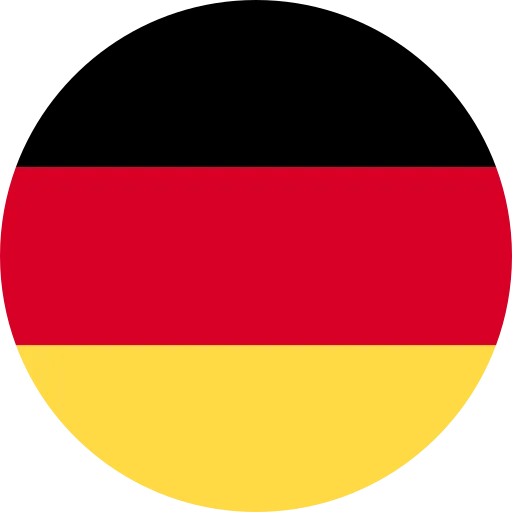Le Musée de Pont-Aven met à l’honneur la figure de la sorcière au XIXe siècle d’un point de vue artistique et imaginaire, mais ne manque pas de rentrer en résonance avec les persécutions modernes contre la femme comme celles visibles en Iran.

© Grand Palais Rmn / Agence Bulloz
Au cœur de notre imaginaire collectif, les sorcières ont longtemps incarné l’allégorie de la vieillesse, de la mort, du vice et du mal. Elles sont associées au surnaturel, à la nature, à ce qui fait peur et que l’on ne maîtrise pas. Mais 1862 marque une rupture avec la publication de La Sorcière de l’historien Jules Michelet : la sorcière devient alors à la fois un emblème de révolte, de connaissance et d’harmonie avec les éléments naturels, posant les bases de l’éco-féminisme.

Ambivalente, la sorcière cristallise les fantasmes masculins sous forme d’icône érotisée dotée d’une éternelle jeunesse s’opposant ainsi à la vieille femme laide des contes et illustrations. Pour des artistes majoritairement masculins, la sorcière évoque l’autre et l’inconnu, avec sa part d’attraction et de menace. Dans une société patriarcale où la femme est considérée comme mineure, la sorcière personnifie la femme forte, qui menace l’ordre établi et deviendra un modèle et un symbole pour les féministes au cours du siècle suivant. Elle incarne la résistance face aux pouvoirs dominants.
Depuis les années 1970, cette figure longtemps mal aimée est devenue un mythe cristallisant les revendications des féministes, un emblème de la résistance contre le patriarcat. Les personnes accusées de sorcellerie, en majorité des femmes, ont été les victimes d’un crime imaginaire, boucs émissaires brûlés et pendus par dizaines de milliers dans l’Europe de la Renaissance.

Superstitions, règlements de comptes et volonté de contrôle politique, déguisés sous des prétextes moraux et religieux sont toujours en cours dans certains pays qui continuent de pratiquer, en plein XXIe siècle, d’autres formes de chasse aux sorcières. Le sous-titre de l’exposition est un hommage discret au slogan « Femme, Vie, Liberté » adopté par les Iraniens en lutte contre l’intolérance et l’obscurantisme religieux du gouvernement de leur pays, suite à l’assassinat d’une femme qui avait osé montrer sa chevelure.

René-Gabriel Ojeda
Tout en s’inscrivant dans ce contexte, l’exposition ne vise pas une réalité historique des sorcières mais s’intéresse à l’imaginaire suscité par cette figure ambiguë et ambivalente, à la manière dont les artistes ont exploré les fantasmes liés à la sorcière et aux nouvelles images qu’ils ont créées. Elle se concentre sur la période 1860-1920, en particulier sur la période du tournant du siècle.
Sorcières ! 1860-1920 Fantasmes, savoirs, liberté. Exposition au Musée de Pont-Aven, du 7 juin au 16 novembre 2025